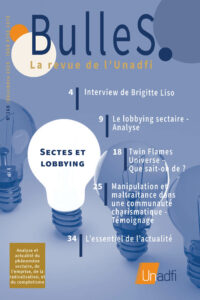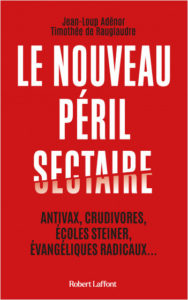Un blog diffusé sur le site internet du « nouvelobs.com » alerte sur le fait que la structure de la famille et l’organisation de l’aide sociale en Allemagne » favorisent l’expansion des mécanismes d’emprise sectaire « sans que les tribunaux aient la culture ni les moyens de s’y opposer ».
Lire la suite
Prévention
Une campagne de sensibilisation
Une nouvelle affiche, tirée à 10.000 exemplaires, sera prochainement diffusée dans des lieux fréquentés par les jeunes et leurs familles en particulier dans les établissements scolaires, les crèches, les services sociaux chargés de la petite enfance, les maisons des adolescents, les Points Info Famille, les Caisses d’allocations familiales…
Lire la suite
La Réunion / Protéger les enfants contre les dérives sectaires
Alors que le procès de la secte « Cœur Douloureux et Immaculé de Marie » se déroule à la Cour d’assises de Saint-Denis de la Réunion, la Fédération des conseils de parents d’élèves (FCPE) rappelle la nécessité de protéger les enfants contre toute forme de dérive sectaire.
Lire la suite
Protéger les mineurs contre l’influence des sectes
Une audition consacrée à la protection des mineurs contre l’influence des sectes était organisée à Paris par la Commission juridique et des droits de l’homme de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe (APCE). A son ouverture, le rapporteur Rudy Salles a déclaré que « ce n’est pas parce qu’il est difficile de trouver un consensus européen sur la problématique des sectes, qu’il faut abandonner l’idée d’établir des règles et des politiques au niveau européen pour protéger les mineurs contre les dérives sectaires ». Il a ajouté qu’il était urgent de présenter des propositions précises pour mieux protéger les enfants, sans pour autant porter atteinte à la liberté de religion.
Lire la suite
En cas de divorce …
Depuis 1993, dans toute procédure le concernant, le mineur « capable de discernement » peut désormais s’exprimer devant le juge ou la personne que celui-ci désigne à cet effet et lui faire part de ses choix de vie quand ses parents se disputent sa garde. Si l’enfant en fait lui-même la demande, son audition ne peut lui être refusée que sur une décision spécialement motivée. Et s’il souhaite être assisté d’un avocat lors de la confrontation, il peut bénéficier de l’aide juridictionnelle, qui prendra en charge les honoraires afférents, de façon qu’il n’ait rien à payer. Cette disposition fait écho à l’article 12 de la Convention internationale, selon lequel chaque enfant a la « possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant ».
Lire la suite
Face à la justice
La victime est une personne qui subit un dommage du fait d’autrui. Elle pourra obtenir réparation soit par voie civile, soit par voie pénale. Cette dernière portant avant tout sur le dommage subi par la société.
Force est de constater que la victime de secte n’a pratiquement jamais recours à la justice, ni pendant sa période d’appartenance à la secte, ni après qu’elle s’en soit libérée. Elle semble paralysée par des raisons psychologiques.
Elle est confrontée à un mécanisme psychologique complexe mettant en jeu des réactions inconscientes qui vont :
Aide à l’accès au droit
Cette aide permet à toute personne d’être informée sur ses droits et ses obligations, en dehors de tout procès, et sur les moyens de les faire valoir ou de les exécuter. Chaque citoyen peut se rendre au palais de justice, aux points d’accès au droit, à la maison de justice et du droit, il y trouvera : Lire la suite
Comment construire une demande en justice?
Un dossier doit toujours être construit clairement et simplement, en ne perdant pas de vue qu’il doit être compris par un tiers, le juge qui attend d’être convaincu.
Lire la suite
Aspects financiers d’un procès
Le premier obstacle à l’accès aux juridictions reste le coût final du procès.
Lire la suite
A quelle juridiction s’adresser?
Chaque type de litige relève de tel ou tel tribunal et en fonction du litige le demandeur doit saisir à la fois le tribunal matèriellement et territorialement compétent.
Lire la suite