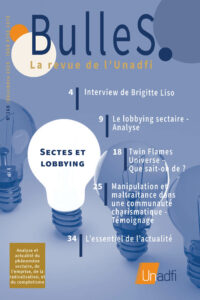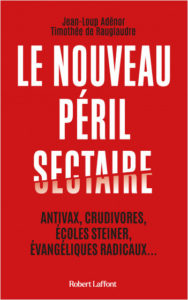Alors que de plus en plus d’Occidentaux se disent « spirituels mais pas religieux », le sociologue belge Galen Watts affirme que de nouvelles formes de spiritualité apparaissent comme une religion émergente. Elles redessinent notre rapport au sacré et influencent profondément la culture, la politique et l’engagement citoyen.
L’Occident connaît une recomposition spirituelle majeure. Dans The Shape of Spirituality, Galen Watts et Dick Houtman analysent ce phénomène en pleine expansion : environ un Américain sur cinq se définit comme « spirituel mais pas religieux », une tendance qui gagne également l’Europe. Ces individus rejettent les dogmes des religions traditionnelles mais adoptent des pratiques visant à un épanouissement personnel perçu comme un impératif moral et existentiel.
Ces nouvelles spiritualités reposent souvent sur une sacralisation du monde naturel, héritée du romantisme et de mouvements comme le transcendantalisme ou la « Nouvelle Pensée » du XIXᵉ siècle. Aujourd’hui, pratiquer le yoga ou la méditation est rarement un simple loisir : pour beaucoup, c’est un moyen de se connecter à un ordre cosmique plus vaste, une quête de transcendance qui, selon Watts, en fait une forme de religion.
Contrairement aux religions établies, ces spiritualités se présentent comme des chemins individuels vers la réalisation de soi. Pourtant, elles possèdent leurs propres normes et modes de socialisation. Dans un groupe de méditation, par exemple, il existe une pression implicite à adopter certaines pratiques et croyances, même en l’absence d’une hiérarchie claire.
Watts compare ces mouvements aux courants mystiques présents dans toutes les grandes religions, comme le soufisme en islam ou la kabbale dans le judaïsme. L’idée centrale est l’expérience directe du divin, sans médiateur institutionnel. Cependant, ces communautés spirituelles génèrent aussi des formes d’autorité implicites, où des figures influentes émergent naturellement, que ce soit un enseignant de yoga ou un coach de développement personnel.
Un impact politique et social croissant
Si ces pratiques mettent l’accent sur l’individu, elles débordent aussi sur le terrain politique. De nombreux adeptes de ces spiritualités s’engagent dans des causes comme l’écologie, le féminisme ou la lutte contre les discriminations. Aux États-Unis, certaines initiatives combinent méditation et prise de conscience des oppressions systémiques, notamment pour déconstruire le racisme ou le patriarcat.
Mais cette posture anti-institutionnelle peut aussi mener à des paradoxes. Pendant la pandémie de Covid-19, des adeptes de la spiritualité alternative se sont retrouvés aux côtés de militants d’extrême droite dans le rejet des vaccins, partageant une même méfiance envers les institutions et la science moderne. Watts parle d’une « alliance surprenante » entre néo-hippies et survivalistes libertariens, illustrant les multiples visages de ces nouvelles spiritualités. Au-delà du bien-être individuel, ces pratiques façonnent ainsi en profondeur la société contemporaine, en redéfinissant notre rapport au sacré, à l’autorité et à l’engagement citoyen. Le sociologue parle de « spiritualités sans Église, mais non sans influence ».
(Source : Le Monde, 16.03.2025)
A lire : The Shape of Spirituality (Octobre 2024), Galen Watts et Dick Houtman, Éditions Presses universitaires de Columbia, 363 pages, 19,24 $ sur Amazon.