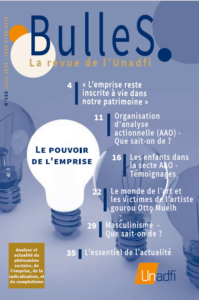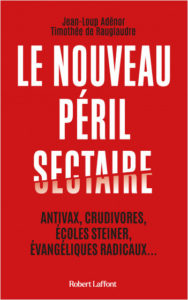L’essor de ces pratiques est porté par l’envie de réduire la consommation d’antibiotiques et une sensibilité croissante aux questions de bien-être animal.
Les Chambres d’agriculture proposent ainsi diverses formations consacrées aux PSNC, de l’acupuncture à l’ostéopathie, en passant par l’homéopathie et le shiatsu. Des initiations sont même proposées par diverses instances, comme des organismes de conseil en élevage, des Groupements de défense sanitaires, voire des vétérinaires. Selon Laurence Fos, coordinatrice formations élevage pour la Chambre d’agriculture de Normandie, « On cherche simplement à répondre aux demandes que formulent les agriculteurs ».
Aujourd’hui, le Conseil national de l’ordre des vétérinaires (CNOV) reconnaît trois pratiques : la physiothérapie (équivalent de la kinésithérapie), la phytothérapie vétérinaire et l’ostéopathie animale.
Christophe Hugnet, membre du CNOV, incite à la prudence : « On associe souvent les médecines douces au bien-être, mais on peut considérer à l’inverse que donner à un bovin un traitement qui n’a aucun effet avéré revient à le laisser dans la souffrance, et différer l’attribution d’un soin éprouvé ». Laurence Fos considère, elle, que les agriculteurs doivent être formés afin de sécuriser leur usage des PSNC : « Je peux vous citer un exemple d’éleveur qui a tué un lot de veaux en utilisant mal les huiles essentielles. Ça n’est pas parce que c’est naturel que c’est inoffensif ».
De fait, un flou juridique entoure aujourd’hui la phytothérapie animale. Il n’existe en effet pas d’autorisation de mise sur le marché (AMM) pour ces produits. L’Anses a proposé une méthode de catégorisation des produits phytothérapeutiques vétérinaires, qui doit désormais être validée au niveau européen : un nouveau cadre réglementaire est attendu pour 2027. De fait, même si ces produits de phytothérapie entrent dans le cadre légal, leur efficacité reste à évaluer dans bien des cas.
De son côté, l’homéopathie perd en popularité, notamment depuis son déremboursement en médecine humaine. Des travaux se sont intéressés à l’efficacité de cette pratique, comme la « comparaison des médicaments vétérinaires et de l’homéopathie vétérinaire » publiée par Peter Lees, membre du Royal Veterinary College de Londres. Sa conclusion est sans appel : « bien que les homéopathes rapportent que leurs remèdes sont efficaces lorsqu’ils sont utilisés dans leur pratique, l’efficacité au-delà du placebo n’est pas apparente dans les essais cliniques bien contrôlés ».
D’autre part, Christophe Hugnet rappelle que « si un vétérinaire administre un traitement et que l’animal va mieux, il existe un fort biais cognitif qui nous amène à croire que le traitement en est responsable, mais cette hypothèse pourrait être erronée ». Dans bien des cas, les maladies guérissent d’elles-mêmes et se seraient résolues avec ou sans traitement, chez les humains comme chez les autres animaux.
Enfin, Christophe Hugnet appelle à la vigilance au sujet des pratiques impliquant la manipulation des animaux : « Si l’animal à des problèmes articulaires, cela peut s’entendre. Si l’on part de quelque chose de plus exotique, autour de l’énergie ou des aspects vibratoires, l’on s’éloigne encore une fois du champ scientifique ». Concernant l’ostéopathie animale, elle ne peut être pratiquée que par des vétérinaires ou des non-vétérinaires formés à l’ostéopathie et inscrits auprès du CNOV.
(Source : Web-Agri, 30.01.2025)