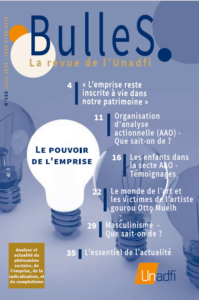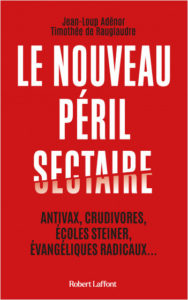Plusieurs infirmiers chercheurs ont analysé la problématique de la spiritualité dans le soin.
Arkadiusz Koselak-Maréchal, infirmier chercheur et formateur en soins infirmiers, a cherché à comprendre pourquoi la religion est souvent invisibilisée au sein de la relation de soin. Yvonne Quenum, infirmière en psychiatrie et chercheuse au CHU de Saint-Etienne, a analysé les enjeux des pratiques religieuses des patients en psychiatrie et les prises en compte et difficultés rencontrées par les professionnels.
Les deux chercheurs soulignent que la spiritualité fait partie des sujets tabous dans le soin, comme peuvent l’être la sexualité ou la consommation d’alcool. Un thème particulièrement sensible en psychiatrie, puisque cette discipline s’est construite en opposition à la religion, qui considérait souvent les troubles psychiatriques comme des problématiques spirituelles. Par ailleurs, les patients y sont parfois considérés comme vulnérables aux risques d’emprise sectaire ou de fanatisme religieux. Certains soignants craignent aussi que les patients voient leurs délires aggravés par la pratique religieuse.
Selon les chercheurs, une mauvaise compréhension de la laïcité participe à l’éviction de la religion des hôpitaux. « La laïcité est souvent vécue comme la neutralité de tout le monde. Selon une interprétation courante, tout ce qui relève de la représentation religieuse ou d’une manifestation de spiritualité n’a pas lieu d’être à l’hôpital. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé explicite cependant l’idée que l’on doit prendre en compte ces sujets », constate Arkadiusz Koselak-Maréchal. Dans les faits, cette prise en compte se limite bien souvent à des aspects pratiques, comme le respect du régime alimentaire du patient.
Les professionnels de santé ne sont pas formés à ces questions, et sont donc influencés par leurs représentations. Selon Yvonne Quenum, « Certains considèrent qu’ils n’ont pas le droit de parler de religion, qu’il n’y a pas de place pour la religion à l’hôpital, ou pour des pratiques discrètes uniquement… ». Du côté des patients, les expériences varient selon les profils : « Les patients peuvent dans ce contexte vivre leur pratique comme quelque chose d’un peu honteux. Certains d’entre eux racontent aussi qu’ils ne se sont pas sentis soutenus dans leur pratique, n’ont pas osé en parler aux professionnels, par exemple pour demander à rencontrer l’intervenant religieux ou aller prier à la chapelle. Ils ont pu avoir l’impression que ce n’était pas un sujet à aborder », explique la chercheuse. Pourtant, si la recherche francophone s’est encore peu emparée de ces questions, des travaux anglo-saxons indiquent qu’aborder la spiritualité avec les patients pourrait avoir un impact sur leur santé mentale.
Yvonne Quenum estime que la formation représente un levier important pour lever ces tabous : « Il y a un manque de formation des professionnels sur la gestion des faits religieux, notamment sur la personne vulnérable comme en psychiatrie ». Elle suggère également de favoriser l’intervention d’un médiateur qui pourrait apporter un regard extérieur sur les situations, et de créer un document, sous la forme d’un « énoncé de principes », afin d’établir les bases d’un cadre de réflexion sur ce sujet. De son côté, Arkadiusz Koselak-Maréchal constate qu’il n’existe actuellement pas de profession de santé « référente » en matière de spiritualité : « Lorsqu’un patient en a besoin c’est donc à nous, infirmier, d’être ce référent. Ce que j’essaye de faire de ce sujet, c’est de le rendre ordinaire. Il faut juste entendre et accueillir, et si on est en mesure, accompagner le patient dans son parcours. Il faut sortir de l’inconnu pour rendre la spiritualité ordinaire, présente ».
(Source : Hospimédia, 27.01.2025)