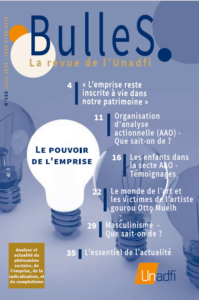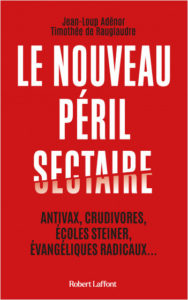La méditation est une pratique spirituelle souvent associée à la relaxation. Elle peut aussi conduire à des expériences traumatisantes.
Membres tétanisés, tremblements, décharges électriques dans le corps, déprime, insomnies… Après des retraites de méditation, ces symptômes ne sont pas rares. C’est ce qu’a constaté Willoughby Britton, chercheuse en psychologie à l’Université Brown. Elle a décidé d’étudier ce phénomène et de tordre le cou aux fausses conceptions que nous pouvons avoir au sujet de la méditation. Pour ce faire, elle a mené une enquête auprès d’un millier de personnes ayant pratiqué la méditation. La moitié de ceux qui ont médité au moins une fois dans leur vie ont dit avoir ressenti des effets secondaires négatifs. Et dans 10 % des cas, ces effets ont duré plus d’un mois et ont affecté leur fonctionnement.
La chercheuse a classé ces effets en catégories. Les effets les plus courants sont d’ordre émotionnels (peur, colère, chagrin, voire absence complète d’émotions). Ils peuvent aussi être cognitifs (difficulté à trouver ses mots, cerveau qui fonctionne au ralenti). Certains ont évoqué une altération des perceptions (hallucinations, couleurs plus vives, objets qui changent de forme). D’autres, des effets somatiques qui englobent des sensations physiques inhabituelles. Certains peuvent aussi éprouver un sentiment de dissociation. Enfin, la docteur Britton a constaté des effets dits conatifs, autrement dit liés à la motivation. « Des gens peuvent être très emballés par leur expérience et vouloir tout quitter pour devenir moines. D’autres au contraire vont perdre toute motivation pour quoi que ce soit et passer de longues périodes assis sur un divan à fixer le mur », explique-t-elle.
Pour venir en aide à ceux qui souffrent de tels effets, la chercheuse a fondé, il y a quelques années, un organisme de soutien appelé Cheetah House. Elle y accueille quelque 150 personnes par mois.
Des risques parfaitement connus en Inde
Rishab Gupta, psychiatre d’origine indienne, aujourd’hui professeur à l’Université Harvard, est surpris de constater que ces effets sont méconnus en Amérique du Nord. « En Inde, les gens sont conscients des risques liés à la méditation. Même les écrits bouddhistes anciens en font mention » souligne-t-il. « La pratique de la méditation a un effet sur certains neurotransmetteurs dans le cerveau. Cela peut augmenter la production de dopamine et donc générer des symptômes psychotiques ». Selon le psychiatre, « un autre neurotransmetteur, le glutamate, pourrait jouer un rôle dans certains effets. Quand il augmente, cela peut mener à des expériences de dépersonnalisation ou de déréalisation ».
Matthew Sacchet, chercheur en sciences cognitives, a quant à lui étudié l’impact de la méditation sur le cerveau en temps réel dans son laboratoire de l’Hôpital général du Massachusetts. Il a observé une variation importante des ondes durant les états de méditation profonde et a constaté qu’ils pouvaient apporter une sensation de bien-être chez les participants. Ils peuvent également produire l’inverse si les personnes ne sont pas préparées. La méditation peut faire émerger des sensations difficiles chez ceux qui ont vécu des expériences traumatisantes.
En outre, contrairement à la croyance populaire, tous les types de méditation n’ont pas pour but la relaxation. « Certaines pratiques n’ont pas des objectifs thérapeutiques mais plutôt religieux », rappelle Nathan Fisher, chercheur en science des religions à l’Université McGill. « Il peut donc y avoir des épreuves difficiles, c’est même intentionnel, souvent avec une intention de purification ».
(Source : Radio Canada, 26.01.2025)
A lire aussi sur le site de l’Unadfi : La méditation, une pratique toujours controversée : https://www.unadfi.org/actualites/domaines-dinfiltration/sante-et-bien-etre/pratiques-non-conventionnelles/la-meditation-une-pratique-toujours-controversee/