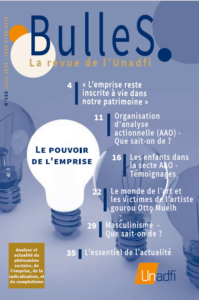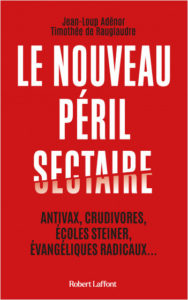Un nouveau phénomène semble émerger aux États-Unis : de jeunes hommes célibataires quittent les églises protestantes, qu’ils jugent trop « féminisées », pour rejoindre l’Église orthodoxe. Attirés par la discipline de cette confession, ils y voient un défi spirituel, physique et mental.
Une enquête réalisée en 2023 par l’Institut d’études orthodoxes dans vingt paroisses de quinze États a révélé que le nombre de convertis à l’Église orthodoxe a augmenté de 80 % en 2022, par rapport au nombre de 2019, avant la pandémie. Parmi eux, 60 % sont des hommes, contre 54 % en 2019.
Beaucoup d’entre eux citent la nature « masculine » de l’église et le dépassement physique comme facteurs déterminants de leur choix.
Matthew Ryan, un ancien athée, fait partie de ces nouveaux fidèles. Professeur en sciences, âgé de 41 ans, il a découvert l’orthodoxie avec une vidéo YouTube. Installé à Salt Lake City, il raconte avoir été attiré par « la structure, l’authenticité et l’historicité » de l’Église. « Ça m’a semblé avoir beaucoup de sens ». Ryan a été baptisé en septembre 2024 et s’investit pleinement dans sa nouvelle foi.
Comme lui, de jeunes hommes disent trouver dans l’Église orthodoxe une réponse à des attentes spirituelles et personnelles insatisfaites ailleurs. Emmanuel Castillo, 32 ans, un ancien militaire ayant servi à Guantanamo Bay, décrit son expérience dans les églises protestantes comme « trop similaire à un samedi soir dans un bar » avec « le même éclairage et la même musique… Ce n’était pas comme ça qu’ils adoraient il y a 2000 ans ». Après avoir étudié la Bible, il a recherché une pratique religieuse qu’il considérait comme fidèle aux enseignements des premiers chrétiens et a rejoint l’église chrétienne orthodoxe Saint Ignatius près de chez lui en Arizona. Ce père de deux enfants a, depuis, quitté l’armée et a été baptisé. Sa page Instagram foisonne d’images de lui, exhibant ses muscles, agrémentées de versets de la Bible. Et il clame à qui veut bien l’entendre que « dans les églises protestantes, la majorité des dirigeants ne sont pas des hommes bons et forts alors que les dirigeants de l’Église orthodoxe sont des figures paternelles ». Pour lui, « Jésus-Christ est l’exemple parfait de la masculinité, quelqu’un capable d’appeler toutes les armées du ciel pour détruire ses ennemis, mais qui a choisi de servir les autres ».
Un défi physique et spirituel
Les prêtres orthodoxes eux-mêmes observent ce phénomène. Le père Paul Truebenbach, de l’Église Saints Pierre et Paul à Salt Lake City, indique que les conversions dans sa paroisse ont triplé depuis la pandémie. « C’est une forme plus dure du christianisme. Beaucoup d’hommes se rendent compte que cette abnégation mène à une paix et une joie que rien d’autre n’apporte », explique-t-il.
Parmi les pratiques attirant ces nouveaux fidèles : des services pouvant durer plus de cinq heures, des périodes de jeûne pouvant atteindre 40 jours, et des rituels considérés comme physiquement exigeants, comme les bains froids. Le père Timothy Pavlatos, de l’église orthodoxe grecque Sainte-Catherine en Arizona, ajoute que « l’orthodoxie est un défi physique et spirituel, un contraste avec une société de gratification instantanée ». Lui a accueilli, en 2024, 29 nouveaux convertis, contre six en moyenne les années précédentes. Il a dû faire appel à des bénévoles et envisage d’ouvrir de nouvelles paroisses.
Le père Seraphim Holland, prêtre à McKinney, au Texas, pense que cet afflux s’explique par le fait que « les nouvelles générations cherchent une foi, mais aussi une communauté qui répond à leurs aspirations spirituelles et identitaires et que l’Église orthodoxe refuse de céder aux querelles culturelles. Nous ne changeons pas, l’Église ne s’oppose pas aux autres, mais reste fidèle à une morale chrétienne constante ».
Des chercheurs ont également constaté « cette dynamique ». Le Dr Sarah Riccardi-Swartz, professeure adjointe de religion et d’anthropologie à l’Université Northeastern, parle « d’une montée spectaculaire » du « christianisme musculaire » et du désir d’une « religion de l’homme fort ». Mais elle pointe aussi des « problèmes idéologiques », soulignant « une misogynie parfois exprimée dans les discours en ligne ».
(Source : The Telegraph, 04.01.2025)
A lire aussi sur le site de L’Unadfi : Des programmes pour « regagner un pouvoir perdu » : https://www.unadfi.org/actualites/groupes-et-mouvances/des-programmes-pour-regagner-un-pouvoir-perdu/