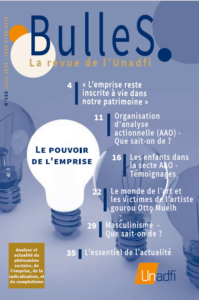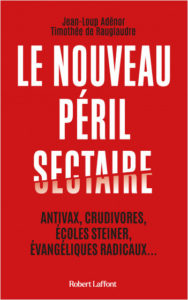Certains dansent, juste comme ça, parce que c’est festif. Les adeptes de danse extatique (autrement appelée ED), eux, recherchent autre chose : une quête spirituelle.
Les consignes pour pratiquer la danse extatique sont simples : écouter le son et laisser le corps s’exprimer de manière libre pour entrer en méditation. Pour Virginie Brune, maîtresse de cérémonie, « La danse est le yoga ultime ». La transe y est recherchée comme « un sommet de liberté », analyse Manéli Farahmand, socio-anthropologue rattachée à l’université de Fribourg (Suisse), qui a consacré sa recherche postdoctorale à l’ED et aux « danses en conscience ».
Des DJ se sont spécialisés pour animer des rassemblements. Les pratiquants, eux, auraient fréquenté des raves et clubs mais auraient aujourd’hui besoin « de plus de profondeur ». Aucun prérequis technique n’est exigé pour rejoindre ce type de mouvement. Quelques lignes directrices sont généralement données : pas de conversation sur le dance floor, pas de drogue ou d’alcool, pas de téléphone. Pour les danseurs, la piste devient un espace sacré où cultiver « le triple lien » : à soi, aux autres et à plus grand que soi. Ils chercheraient à trouver, dans le mouvement, qui ils sont vraiment, à ressentir plutôt que penser. Certains confessent que cette pratique répond « à un besoin de libération de l’instinct et de l’intelligence de l’âme » qui auraient été réprimés par l’éducation et des structures sociales contrôlantes.
Développement de la danse extatique dans les années 2000
« Historiquement, l’ED a vu le jour à Hawaï dans les années 2000 par le danseur Max Fathom », explique la chercheuse. « Il s’est inspiré de la musicienne et écrivaine Gabrielle Roth qui avait mis en place la danse des cinq rythmes (5R), une danse méditative basée sur cinq types de techniques différentes, censés être adaptés à cinq sortes d’énergies présentes en nous ». La pratique de l’ED s’est ensuite propagée sur tous les continents. Des séances sont proposées dans la plupart des grandes métropoles, pour des tarifs allant de 20 € à plus de 1 000 € pour un suivi par un maître de cérémonie pendant plusieurs mois. « Il s’agit généralement d’un public issu de la classe moyenne supérieure », a constaté Manéli Farahmand, « et les adeptes de ces danses ont souvent déjà un pied dans l’univers des thérapies non conventionnelles ». Ils considèreraient ces danses extatiques comme une nouvelle forme de spiritualité contemporaine. « Pour eux, danser signifie en réalité rompre avec l’autorité extérieure, s’écouter soi-même, faire confiance à son intelligence corporelle, plutôt qu’à toute forme d’autorité ou d’influence sur nos choix d’existence », décrypte Manéli Farahmand.
Pourtant, derrière la liberté revendiquée, ces sessions sont « traversées de codes, de normes, implicites ou explicites », nuance l’anthropologue. « Par exemple, les cercles de parole venant clôturer chaque séance, présentés comme un espace apaisé où l’on peut partager des émotions authentiques, aboutissent souvent à une surenchère de positivité normative martelée par les encadrants ». Certains pourraient s’en inquiéter. Elle, préfère relativiser : « Ce qui est intéressant, c’est la réflexivité encouragée dans ces milieux. Si des conflits émergent, certains peuvent se servir des cercles de parole ou même de la danse pour en prendre conscience et travailler dessus, comme un tremplin pour l’introspection ».
(Source : Le Monde, 31.12.2024)