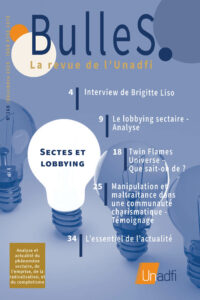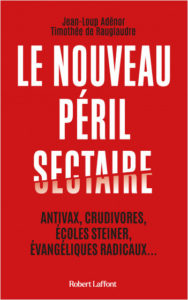Perçue par beaucoup comme un « remède idéal » contre le stress et les troubles de la santé mentale, la méditation pleine conscience séduit de plus en plus d’adeptes en Occident. Mais les effets secondaires de cette pratique issue du bouddhisme, parfois graves, sont largement ignorés.
La méditation pleine conscience consiste à porter une attention consciente à ce que l’on ressent, pense et perçoit dans l’instant présent. Cette pratique semble s’ancrer dans des routines de santé. Mais un débat éthique devient urgent. Peut-on promouvoir une pratique aux effets potentiellement nocifs sans avertir les usagers ?
Des études récentes, dont une menée en 2022 aux États-Unis, révèlent que plus de 10 % des pratiquants réguliers ont connu des troubles importants (anxiété, dépression, dissociation, etc.) durant au moins un mois. Ces symptômes, recensés depuis des siècles dans les écrits bouddhistes, peuvent survenir même chez des individus sans antécédents psychiatriques. Une analyse de plus de 40 ans de recherches confirme que les effets indésirables ne sont ni rares ni anodins.
Malgré ces signaux, le discours dominant autour de la pleine conscience reste très favorable. Il faut dire qu’il est porté par une industrie florissante : 2,2 milliards de dollars aux États-Unis, trois millions d’utilisateurs pour l’application française Petit Bambou par exemple. Et des entreprises comme la SNCF ou Deloitte l’intègrent désormais à leurs programmes internes.
Cette popularité s’appuie sur des recherches dites scientifiques mais parfois de faible qualité. Jon Kabat-Zinn, figure emblématique du mouvement, a reconnu, en 2017, que « 90 % des études [positives] sont médiocres ». Quant à la plus vaste étude britannique sur le sujet, menée auprès de 8000 enfants, elle n’a montré aucun bénéfice significatif et suggère même des effets délétères chez les plus fragiles.
Face à ces constats, des voix s’élèvent pour réclamer davantage de transparence et une meilleure information des usagers. Le professeur Ronald Purser dénonce dans son ouvrage McMindfulness une « spiritualité capitaliste ». Aux États-Unis, un service clinique spécialisé dans les troubles liés à la méditation a même vu le jour.
(Source s: Ouest-France, 03.06.2025 & Actu Santé, 04.06.2025)
A lire aussi sur le site de l’Unadfi : Les croyances sous-jacentes de la pleine conscience : https://www.unadfi.org/actualites/domaines-dinfiltration/sante-et-bien-etre/les-croyances-sous-jacentes-de-la-pleine-conscience/