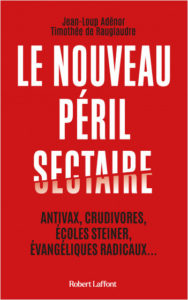Neutralité de l’école publique, financement des établissements privés religieux… Les évangéliques québécois interpellent les autorités.
Face aux récentes controverses sur le prosélytisme dans les écoles publiques québécoises, le Réseau évangélique du Québec (REQ) monte au créneau. Il plaide pour la création d’un organisme indépendant, chargé de veiller au respect de la laïcité dans l’éducation. Cette proposition intervient dans un contexte de vif débat sur la place de la religion dans les établissements scolaires.
Jean-Christophe Jasmin, directeur des affaires externes du REQ, dénonce une « instrumentalisation du religieux à des fins politiques » et critique la réaction des partis politiques (le Parti libéral, le Parti québécois et Québec Solidaire) qui proposent de couper le financement des écoles privées religieuses, alors que le problème concerne des écoles publiques. Pour lui, on se trompe de cible : « les écoles privées sont éclaboussées alors que c’est l’école laïque qui n’applique pas les lois et l’État qui faillit à sa neutralité religieuse ».
L’Observatoire français pris en exemple
Le REQ s’inquiète également de la discrimination croissante envers les minorités religieuses. Il cite les difficultés pour des groupes évangéliques à louer des espaces publics. Jean-Christophe Jasmin appelle à la création d’un organisme neutre, sur le modèle de l’Observatoire de la laïcité en France, pour clarifier l’interprétation de la loi et traiter les plaintes.
Cette controverse fait suite à un rapport d’enquête sur l’école Bedford à Montréal, révélant des pratiques religieuses inappropriées dans un établissement public et « des enseignants qui enfreignent leur devoir de réserve ». Le débat s’est élargi, touchant la question du financement des écoles privées religieuses, qui reçoivent environ 160 millions de dollars par an d’argent public au Québec. Le REQ met en garde contre les conséquences d’un définancement de ces écoles religieuses, catholiques, protestantes évangéliques, musulmanes, juives ou orthodoxes, qui seraient au nombre de cinquante. Il appelle à trouver une réponse équilibrée à une question complexe qui engendre des débats épidermiques, « pour le bien des enfants ».
(Source : La Presse, 04.11.2024)