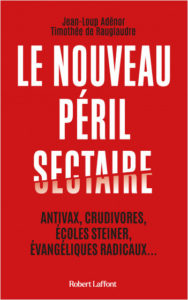Le numéro 53 du magazine de l’Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale (Inserm), paru en mai 2022, aborde dans un article intitulé « Dérives sectaires en santé : une période de crise ? », les risques de dérives sectaires dans le champ de la santé, en particulier en ce qui concerne les pratiques non conventionnelles et s’interroge sur la façon de les limiter en les encadrant davantage.
Selon un sondage publié en janvier 2022 par l’Unadfi et Odoxa, 30 % de français pensent que la santé est un secteur menacé par les dérives sectaires. C’est, en effet, ces dernières années le principal sujet de préoccupation de la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes). En 2019-2020, la Mission a reçu 730 saisines touchant à la santé et en 2020-2021 ce domaine représentait 38 % de ses signalements. Mais, explique Samir Kalfaoui, conseiller santé de la Mission, « nous manquons d’outils spécifiques pour chiffrer rigoureusement ce phénomène », aussi le risque de le sous-évaluer est important, d’autant plus que « la majorité des victimes éprouvent un sentiment de honte qui les dissuadent de faire un signalement » ajoute-t-il.
Contrairement à ce pensent 76 % des Français interrogés par Odoxa et l’Unadfi, « les personnes dépressives, en situation de précarité et les adolescents », ne sont pas les seuls risquant d’être victimes de secte. Tout le monde est susceptible d’être touché, « il n’y a pas de profil type » observe Samir Kalfaoui. En ce qui concerne le domaine de la santé, « la souffrance ou l’inquiétude liées à une maladie et la confiance accordée au « soignant » « favorisent le risque d’emprise pour le patient » explique Bruno Falissard, psychiatre et directeur du Centre de recherche en épidémiologie et santé des populations à Villejuif (CESP). Dans ce contexte, le patient peut se voir soutirer de l’argent, rompre avec ses proches, mais aussi « perdre des chances de guérison en renonçant à des soins éprouvés. »
Si les dérives sectaires en matière de santé peuvent concerner les soins dispensés par des médecins, elles sont majorées dans le champ des médecines alternatives qui, « en plus d’être mal évaluées, voire pas du tout, […] ne sont pas réglementées, ni standardisées » prévient Bruno Falissard.
Face à la déferlante de pratiques -près de 400, recensées par la Miviludes- et à l’engouement des Français pour celles-ci -quatre sur dix y recourent, dont 60 % des malades du cancer- se pose la question de leur évaluation et de leur encadrement.
L’Inserm a déjà étudié plusieurs méthodes dans le cadre de sa mission temporaire visant à évaluer scientifiquement les Médecines Complémentaires et Alternatives (MCA). Les douze rapports qu’elle a produits depuis 2010 ont souvent conclu à « un faible niveau de preuve d’efficacité selon les critères de la recherche médicale, mais aussi au manque de travaux dans ces domaines. »
Gregory Ninot, Directeur adjoint de l’Institut Desbrest d’Epidémiologie et de Santé Publique à Montpellier (UM – INSERM), à l’origine de la création de la Société savante des interventions sans médicaments, en octobre 2021, pense possible une évaluation des MCA. La Société a pour objectif de distinguer celles qui sont sectaires de celles qui seraient sans risques et de faciliter leur intégration à l’hôpital quand elles s’avèrent efficaces.
A la Miviludes, on plaide plutôt pour une réactivation du Groupe d’appui technique sur les pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique (GAT) dont le décret de suppression a été promulgué en 2020. Créé en 2009, il avait, entre autres, pour mission d’aider au « repérage et à la classification des PNCAVT (pratiques non conventionnelles à visée thérapeutique) dangereuses ou au contraire prometteuses. » Pour Samir Kalfaoui, « ce groupe a rendu d’excellents travaux sur l’évaluation de ce type d’approches. »
(Source : Inserm, Le Magazine, n°53, mai 2022)