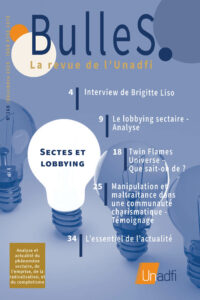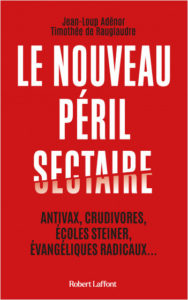La pandémie a eu l’effet d’un catalyseur pour les théories complotistes, largement relayées sur les réseaux sociaux.
Depuis le covid-19, les théories du complot semblent se diffuser à grande vitesse. Ainsi, selon une enquête de 2023 menée par l’IFOP et le site Amb-USA, 29 % des Français croient toujours en l’efficacité de la chloroquine du professeur Raoult contre le covid, tandis que 35 % d’entre eux adhèrent aux théories du complot.
Selon la chercheuse Valérie Igounet, les thèses complotistes se renouvellent « pour l’essentiel par l’actualisation de mythes complotistes préexistants ». Par exemple, l’absence d’autorisation de la chloroquine s’expliquerait, selon les complotistes, par l’influence de Big Pharma et sa volonté de commercialiser un vaccin permettant d’importants gains financiers.
La pandémie a amplifié le développement de ces théories : face à l’incertitude provoquée par le covid, les individus ont mobilisé de nouvelles ressources pour s’informer, comme les réseaux sociaux, au détriment de la parole des experts. De fait, la défiance envers les institutions compte parmi les facteurs d’adhésion aux théories du complot, selon plusieurs travaux de recherche. « Durant la crise sanitaire, la méfiance envers les autorités publiques a pu être alimentée par l’insatisfaction à l’égard de la gestion de la pandémie – port du masque, mesures de confinement, couvre-feu – ou encore par la politisation des enjeux de santé et d’autres enjeux socio-économiques », relève la chercheuse en sciences politiques Tania Gosselin.
Heureusement « Exposition n’égale pas contamination », l’exposition à des théories du complot sur les réseaux sociaux n’entraîne pas forcément l’adhésion. De même, l’intérêt des médias pour le sujet du complotisme a également permis de décrédibiliser certaines théories : « L’attention grandissante portée aux théories du complot par les médias traditionnels du Québec et d’ailleurs, avant et durant la pandémie, a probablement contribué à sensibiliser la population à ce phénomène ».
Toutefois, le développement des « fact-checkers » au sein des rédactions n’est pas sans effet collatéral : selon une enquête récente de Vérian, une partie des Français se méfient aujourd’hui de la lutte contre la désinformation : « Certaines personnes vont suspecter un journaliste d’être partisan parce qu’il débunke telle info plutôt qu’une autre », explique la société de sondage.
(Sources : SudOuest, 17.03.2025, Actualités UQAM, 10.03.2025, Le Monde, 22.03.2025)