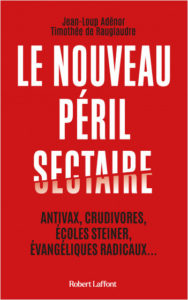Les religions traditionnelles s’essoufflent en Suisse. Mais « de nouvelles formes de croyances, plus libres et plus hybrides, émergent » explique Manéli Farahmand, directrice du Centre intercantonal d’information sur les croyances (CIC).
Les chiffres de l’Office fédéral de la statistique (OFS) confirment une mutation profonde en matière de pratiques religieuses en Suisse. Pour la première fois, les personnes sans appartenance religieuse (34 %) dépassent les catholiques (32 %), tandis que les réformés, autrefois majoritaires, ne représentent plus qu’un cinquième de la population. Les musulmans se maintiennent autour de 6 %, et les communautés orthodoxes ou évangéliques progressent légèrement.
Selon Manéli Farahmand, docteure en socio-anthropologie des religions et directrice du CIC depuis 2020, ce recul des appartenances traditionnelles ne signe pas la fin du spirituel. « Le spirituel non religieux connaît une croissance marquée depuis 2009, surtout chez les jeunes femmes diplômées issues des classes moyennes », observe-t-elle. Ces nouvelles sensibilités, souvent portées par des valeurs écologiques, recomposent le paysage des croyances.
Après la vague du yoga et de la méditation des années 2000-2015, de nouvelles pratiques plus cérémonielles se développent comme les danses chamaniques ou cérémonies de cacao. Ces démarches, souvent collectives, empruntent librement à différentes cultures.
Les cercles de femmes se multiplient, autour de thématiques comme la maternité, la sexualité ou les cycles lunaires. « Ils s’inscrivent dans ce qu’on appelle les spiritualités au féminin. Mais ils peuvent aussi reconduire certains stéréotypes de genre » note-t-elle. Des cercles d’hommes apparaissent aussi. « Certains prônent la guérison du « masculin blessé », d’autres flirtent avec des discours plus identitaires ou masculinistes ».
Les plateformes numériques jouent un rôle central dans cette mutation. Des influenceurs spirituels se sont imposés sur Instagram ou TikTok. Le mouvement « witchtok », qui réunit des milliers de « sorcières 2.0 », illustre cette tendance. « L’autorité spirituelle ne vient plus d’une institution, mais du récit personnel », souligne Manéli Farahmand. Le vécu, les témoignages et les interactions en ligne fondent désormais la légitimité des nouvelles figures spirituelles.
Pour le CIC, les prochaines années verront l’essor des éco-spiritualités, ancrées dans la préoccupation écologique et la recherche d’un lien renouvelé avec la nature. Pour elle, « la vitalité spirituelle ne disparaît pas, elle se transforme. Les communautés établies se réinventent ».
(Source : La Liberté, 13.10.2025)
A lire aussi sur le site de l’Unadfi : Des spiritualités sans Eglises, mais non sans influence : https://www.unadfi.org/prevention/cles-pour-comprendre/des-spiritualites-sans-eglises-mais-non-sans-influence/