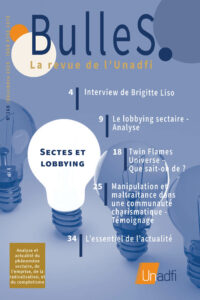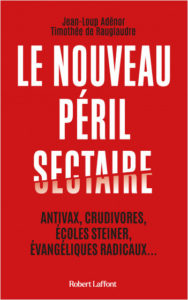Un enfant de onze ans est-il capable de distinguer une vraie information d’une fausse ? « Non », tranche une étude du CNRS. Proposée à 432 enfants de onze à quatorze ans, elle a testé leur capacité à repérer le vrai du faux dans 56 nouvelles publiés en posts sur les réseaux sociaux.
Premier constat : « plus les collégiens sont âgés, mieux ils repèrent les fausses informations », explique Marine Lemaire, doctorante au LaPsyDÉ (1), auteur de l’étude. « Tous les individus ne sont pas armés face aux fake news, notamment les adolescents, dont le développement cérébral ne s’achève qu’entre 20 et 25 ans ». À 11 ans, aucune différence statistique significative n’a été trouvée sur la capacité à distinguer une vraie nouvelle d’une infox. Cette capacité progresse avec l’âge et le développement du raisonnement, mais reste limitée face à certains biais cognitifs.
Parmi ceux-ci, l’effet de vérité illusoire : « Plus on voit une information, plus on a tendance à croire qu’elle est vraie ». Il s’agit, selon elle, d’un phénomène « robuste, détecté dès 5 ans » et qui touche adultes comme enfants. Cette vulnérabilité est amplifiée à l’ère des réseaux sociaux, où circulent des rumeurs massives.
Pour Grégoire Borst, directeur du LaPsyDÉ, la clé réside dans l’éducation. « Il est possible d’expliquer aux enfants le fonctionnement des algorithmes… Mais encore faut-il en avoir conscience soi-même ». L’EMI (éducation aux médias et à l’information), généralisée par une circulaire du ministère en 2022, doit encore progresser.
L’esprit critique peut aussi basculer dans le complotisme. Antonio Casilli, sociologue à Télécom Paris, met en garde : « La vraie difficulté est de développer la pensée critique des adolescents tout en évitant qu’ils se mettent à douter de toutes les informations ». Car l’adhésion à des théories complotistes peut vite devenir un refuge.
Les adolescents se montrent néanmoins plus prudents que d’autres, « ils ne partagent pas forcément les fake news contrairement aux personnes âgées », rappelle le Journal du CNRS. Lors de la présidentielle américaine de 2016, « les plus de 65 ans avaient partagé en moyenne sept fois plus d’infox sur Facebook que les 18-29 ans ».
Grégoire Borst plaide pour « cultiver le doute raisonnable ». Il invite à systématiquement vérifier une information s’il y a un doute, surtout si elle paraît « trop sensationnelle, trop belle, trop quelque chose ». Cette pédagogie lui parait encore plus indispensable à l’heure où Meta et X allègent leurs politiques de modération, misant davantage sur l’autorégulation des utilisateurs.
(Source : Next, 08.09.2025)
Laboratoire de Psychologie du Développement et de l’Éducation de l’enfant, CNRS