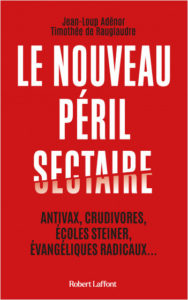Nadine, professionnelle de santé, a été entraînée en quelques mois, avec son compagnon, dans un enfermement psychologique qui a failli la conduire en hôpital psychiatrique, avec des risques pour sa carrière.
Constatant des changements incompréhensibles dans la vie et les relations du couple, l’entourage a réagi rapidement, s’informant pour comprendre, prenant conseil auprès de l’ADFI locale sur les attitudes à adopter face à une telle situation, et essayant d’agir ensemble.
Manipulation mentale
Le gourou présumé des Reclus de Monflanquin condamné
A l’automne 2001, onze membres d’une même famille, les Védrines, ont vécu reclus dans leur propriété de Monflanquin dans le Lot-et-Garonne. Ils y resteront jusqu’en 2008, date à laquelle certains rejoindront à Oxford (Grande-Bretagne) leur « gourou » présumé, Thierry Tilly. Ce dernier est soupçonné de les avoir manipulés et ruinés : en huit ans les Védrines ont ainsi été dépouillés de leurs biens. Le bénéfice que pourrait en avoir tiré Thierry Tilly est estimé à 4 millions d’euros. Trois personnes sont mises en examen dans ce dossier.
Lire la suite
Les dérapages des psys
Une mise en garde qui vise certains psys susceptibles de devenir «nuisibles», sinon toxiques. Ainsi en est-il des promoteurs du «cri primal» ou du «rebirth», techniques très en vogue aux États-Unis dans les années 2000 et qui consistent à aider le patient à revivre les émotions premières de sa naissance. Des phénomènes de «décompensation» très graves ont été observés chez certains patients adeptes de ces méthodes…
Lire la suite
Etats-Unis / Le combat d’un ex-scientologue
Mark Rathbun, 54 ans, a passé 27 ans dans la Scientologie. Depuis sa défection en 2004, il a parlé au FBI de l’abus physique et mental qui se passe au plus haut niveau de l’organisation. Il a aussi participé en 2009 à une enquête du Saint Peterburg Times mettant en cause la Scientologie.
Lire la suite
Jesus Camp
Dans « Jesus Camp », situé dans le Dakota du Nord, une femme pasteur, Becky Fischer, endoctrine et fanatise des enfants à l’âge où ils sont le plus « impressionnables », à savoir entre 7 et 9 ans (mais pas au-delà de 13 !)
Lire la suite
Femmes légionnaires ?
Dans un article de l’Associated Press de 2010, des femmes appartenant à la branche laïque des Légionnaires du Christ (Regnum Christi) ont relaté leurs conditions de vie comparables à celles menées dans des sectes : soumission à des règles presque à chaque minute de la journée « au nom de la volonté de Dieu ».
Lire la suite
Apostat, une accusation récurrente
En guise d’introduction, il nous a paru essentiel de reprendre les grandes lignes d’une analyse menée par Jean-Pierre Jougla (avoué, membre de longue date de l’ADFI et administrateur de l’UNADFI) sur l’accusation d’apostasie, accusation destinée à neutraliser les témoignages douloureux qu’apportent d’anciens adeptes.
Le gourou de Béthune
David J., 38 ans, est un « beau parleur » qui se retrouve au tribunal de Béthune. Un escroc surtout qui s’est fait remettre d’importantes sommes de différentes victimes, des femmes rencontrées sur internet.
Lire la suite
Editorial
L’emprise, qui vise à obtenir d’un individu, par diverses techniques, un engagement durable et extensif suppose que soit limitée ou même exclue toute critique ou influence divergente. Les dérives sectaires s’accompagnent donc, le plus souvent, de stratégies éprouvées pour isoler les victimes de leur environnement familial et social : activités multiples, obligatoires ou fortement encouragées, déplacements fréquents ou envoi dans un pays lointain, déménagement avec adresse tenue secrète, allusions négatives ou accusations graves envers des personnes de l’entourage proche, etc.
Lorsque l’emprise s’exerce au sein d’un groupe, cette coupure avec l’extérieur se double d’un contrôle des relations entre les membres ; le gourou s’immisce dans les relations amicales, intervient pour faire ou défaire des couples, se substitue aux parents auprès de leurs enfants.
Les liens, fondés sur le partage de croyances et de pratiques imposées, ne sont bien souvent qu’apparence, les membres apprennent à se méfier les uns des autres.
Sur l’individu ainsi subtilement isolé, le gourou (ou les dirigeants) fait pression pour contrecarrer tout désir d’autonomie. L’emprise ne supporte en effet aucun désaccord ou comportement non conforme, la sanction est alors l’exclusion… La responsabilité en incombe tout entière à l’exclu. Il est accusé de trahison, d’actions ou d’intentions perverses, sa réputation est détruite, et les adeptes restés dans le groupe doivent l’éviter.
Quelles que soient les motivations de ce bannissement — inciter la personne à faire totale allégeance pour espérer retrouver les siens, garder « pure » la communauté en la préservant de toute « contamination », terroriser les membres restants — cette pratique est une atteinte à la liberté de conscience[1]. Cette atteinte doit être dénoncée et devrait être sanctionnée… s’il n’était pas si difficile et incertain pour les victimes de porter plainte.
Une fois encore, il faut insister sur la nécessité de développer la connaissance et la compréhension du phénomène d’emprise notamment auprès des acteurs de la Justice.
[1] Déclaration universelle des Droits de l’Homme, Article 18 : « Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion ; ce droit implique la liberté de changer de religion ou de conviction […] »
Isoler, déchoir, bannir
L’emprise, qui vise à obtenir d’un individu, par diverses techniques, un engagement durable et extensif suppose que soit limitée ou même exclue toute critique ou influence divergente. Les dérives sectaires s’accompagnent donc, le plus souvent, de stratégies éprouvées pour isoler les victimes de leur environnement familial et social : activités multiples, obligatoires ou fortement encouragées, déplacements fréquents ou envoi dans un pays lointain, déménagement avec adresse tenue secrète, allusions négatives ou accusations graves envers des personnes de l’entourage proche, etc.
Lire la suite