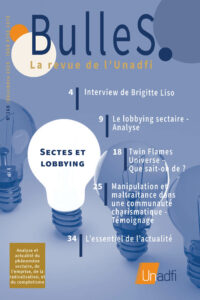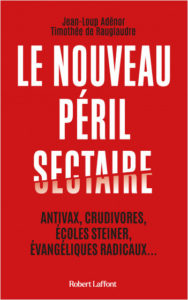Les souvenirs fabriqués sous influence thérapeutique représentent une nouvelle forme de manipulation mentale, insidieuse et destructrice. Si le mouvement #MeToo a permis une libération essentielle de la parole des victimes de violences sexuelles, certaines pratiques pseudo-thérapeutiques exploitent aujourd’hui cette dynamique à des fins de contrôle psychologique.
Le phénomène est redoutable. Sous hypnose, analyse ou simple thérapie, certains praticiens peu scrupuleux amènent leurs patients à se « remémorer » des agressions sexuelles imaginaires, souvent dans le cadre familial. Cette dérive sectaire est bien identifiée par la Miviludes, organisme chargé de surveiller les phénomènes d’emprise mentale en France.
Sonia, victime de cette manipulation, a vu sa vie basculer après des séances avec Marie-Catherine Phanekham, fausse thérapeute condamnée en 2017. Convaincue d’avoir été victime d’inceste, elle s’est isolée, a divorcé, et n’a retrouvé un semblant de lucidité que lorsque sa propre fille a commencé à « se souvenir » d’agressions similaires, suggérées par la même manipulatrice.
Si la justice peine à s’emparer de ces cas, à la frontière entre psychologie, droit et foi en la mémoire, deux procès en France ont établi la responsabilité de thérapeutes ayant implanté de faux souvenirs. Le cas le plus frappant est celui de Benoît Yang Ting, dont plusieurs patientes ont affirmé, sous son emprise, avoir survécu à des tentatives d’avortement… in utero.
Le sujet reste explosif, notamment dans un contexte post-MeToo. L’argument des faux souvenirs a déjà été utilisé à tort pour tenter de discréditer de vraies victimes, rendant la ligne de crête très fine. Le problème, c’est que lorsque l’hypothèse des faux souvenirs induits est utilisée, elle sème un doute « intolérable » selon Catherine Katz, ancienne magistrate. « C’est la pire situation qui puisse arriver à un juge parce qu’on est face à des gens qui peuvent nous raconter des horreurs complètement fausses avec la plus extrême sincérité ». À la différence d’une enquête judiciaire où il s’agit d’identifier qui ment et qui dit la vérité, dans le cas où l’hypothèse des faux souvenirs induits est confirmée, « personne ne ment » poursuit la présidente de l’Unadfi, « accusateurs et accusés sont convaincus de ce qu’ils avancent ».
Malgré sa marginalité statistique (quelques centaines de cas pour plus de 120 000 victimes de violences sexuelles signalées chaque année), le phénomène soulève des enjeux cruciaux pour la justice et la santé mentale. Comme le rappelle la philosophe Brigitte Axelrad, « la mémoire est malléable, seul le recoupement avec des preuves objectives peut départager l’imaginaire du réel ».
Sonia, victime à la fois de vraies maltraitances et de faux souvenirs, incarne cette complexité. Son témoignage révèle que les deux réalités peuvent coexister. Et que, dans un système encore peu outillé face à ces dérives, des vies peuvent être brisées… Au nom d’une vérité fabriquée.
(Source : Charlie Hebdo, 26.05.2025)
A lire aussi sur le site de l’Unadfi : Faux souvenirs induits mais conséquences désastreuses bien réelles : https://www.unadfi.org/actualites/domaines-dinfiltration/sante-et-bien-etre/psychotherapie-et-developpement-personnel/faux-souvenirs-induits-mais-consequences-desastreuses-bien-reelles/