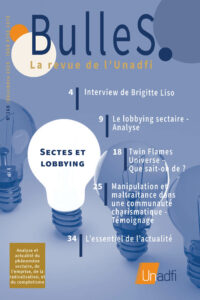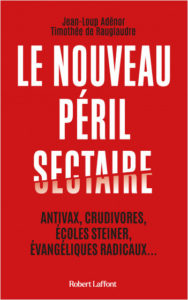Le point commun entre Tariq Ramadan, Donald Trump, Andrew Tate, Russell Brand ou encore Juan Branco ? Des accusations de violences sexuelles. Et une même stratégie de défense : crier au complot pour contester les allégations… Et se poser en victime d’un « système ».
Condamné pour viol et contrainte sexuelle par la justice suisse, Tariq Ramadan a lancé fin septembre une vaste contre-offensive médiatique. Il prétend détenir de nouvelles preuves de son innocence et dénonce une machination concertée. Le théologien parle d’un « plan » ourdi par ses plaignantes, des « réseaux pro-israéliens » et ses « adversaires idéologiques ».
La stratégie n’est pas née avec Ramadan. Donald Trump en a donné la version la plus tonitruante en 2016, après la diffusion de la vidéo où il se vantait de « pouvoir tout faire aux femmes ». Accusé par plusieurs plaignantes, il riposte en accusant les démocrates et les médias de mener un « vaste complot » pour truquer l’élection. Le discours fonctionne… Il est élu trois semaines plus tard.
L’influenceur masculiniste Andrew Tate s’inscrit aussi dans cette lignée. Poursuivi en Roumanie pour viols et traite d’êtres humains, il accuse un « système » de vouloir le détruire. Sur X, il évoque la « Matrice », un pouvoir mondial qui chercherait à faire taire les hommes « libres ». Et plus il est poursuivi, plus sa légende d’homme « censuré » s’ancre auprès de ses adeptes.
Même scénario outre-Manche. Russell Brand, comédien et figure majeure de la complosphère britannique, est mis en examen pour viol et agressions sexuelles. Il ne se défend pas sur le fond, il dénonce une « attaque coordonnée » menée par les médias et le gouvernement. Son soutien par des figures comme Tucker Carlson ou Donald Trump renforce cette image d’« homme à abattre » par l’establishment. Résultat : son audience explose et sa communauté se radicalise.
En France, l’avocat et essayiste Juan Branco emprunte la même voie. Dans ses livres comme dans ses prises de parole, il théorise la destruction des figures dissidentes par le « rouleau compresseur politico-médiatique ». Mis en examen pour viol, il dénonce un « complot d’État » et se pose en victime d’une justice « pourrie ». Cette rhétorique s’accompagne d’une attaque en règle contre le mouvement #MeToo et certaines victimes.
Un mécanisme bien rodé
À travers ces cas, on voit se dessiner un schéma récurrent et une stratégie diaboliquement efficace. Il s’agit d’anticiper les accusations en se présentant comme cible politique ou idéologique, délégitimer les institutions en les accusant de manipulation, transformer les accusations en « preuves de persécution » et ainsi renforcer sa base militante imperméable aux faits. Le complotisme devient alors un moyen de détourner le récit judiciaire vers le terrain politique. Il permet de brouiller la frontière entre agresseur et victime, et d’imposer un nouveau mythe : celui du « dissident » sacrifié sur l’autel du système. Ce discours fonctionne d’autant mieux qu’il s’inscrit dans une ère de méfiance généralisée. En inversant la charge morale, ces figures parviennent à se positionner comme porte-voix d’une lutte contre l’ordre établi. Et leur audience ne faiblit pas. Trump reste une force politique majeure, Tate et Brand continuent de prospérer sur les réseaux, Ramadan et Branco mobilisent des cercles de fidèles convaincus.
(Source : Conspiracy Watch, 15.10.2025)