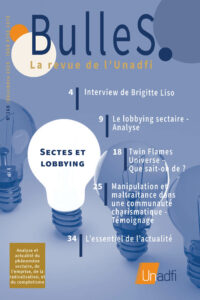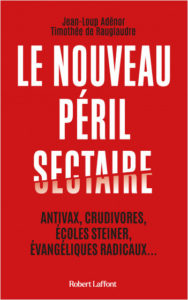La cérémonie organisée à Glendale, en Arizona, pour honorer Charlie Kirk n’était pas qu’un hommage funèbre. Elle a consacré la fusion entre la ferveur religieuse et le pouvoir politique. Devant 65 000 fidèles, Donald Trump a célébré son « martyr » et appelé à « ramener Dieu en Amérique ». Le ton n’était pas celui de la commémoration, mais de la mobilisation.
Ce moment marque un basculement. La mouvance évangélique et catholique ultra conservatrice, longtemps cantonnée au rôle de soutien électoral, s’installe au centre de la machine d’État. Autour du président, des figures traduisent l’enracinement institutionnel du nationalisme chrétien. On y trouve la télévangéliste Paula White-Cain, le secrétaire à la Défense Pete Hegseth, le président de la Chambre Mike Johnson ou encore le vice-président J.D. Vance.
Selon le sociologue Philippe Gonzalez, « cette présence massive n’est pas fortuite. Elle résulte d’un long travail de structuration intellectuelle et militante entamé depuis les années 1980. L’objectif n’est plus d’influencer le politique, mais d’en prendre le contrôle ».
Donald Trump en a compris la portée stratégique. En retour, il offre à ces acteurs une plateforme politique inédite. Dès son retour à la Maison-Blanche, il a signé un décret mettant fin aux « persécutions antichrétiennes » de l’ère Biden et nommé des conseillers issus directement des milieux évangéliques. Son discours, articulé autour de la défense de la nation chrétienne et du rejet du libéralisme sociétal, alimente la légitimité d’un projet de reconquête culturelle et morale.
Face à cette dynamique, les contre-pouvoirs demeurent faibles. Ni la hiérarchie catholique, divisée, ni les initiatives progressistes internes au monde évangélique ne parviennent à enrayer l’ascension de ce bloc religieux-nationaliste. Pour le nouveau pape Léon XIV, qui a repris l’héritage social de son prédécesseur, ce nationalisme chrétien est un défi de taille.
(Source : Libération, 22.10.2025)